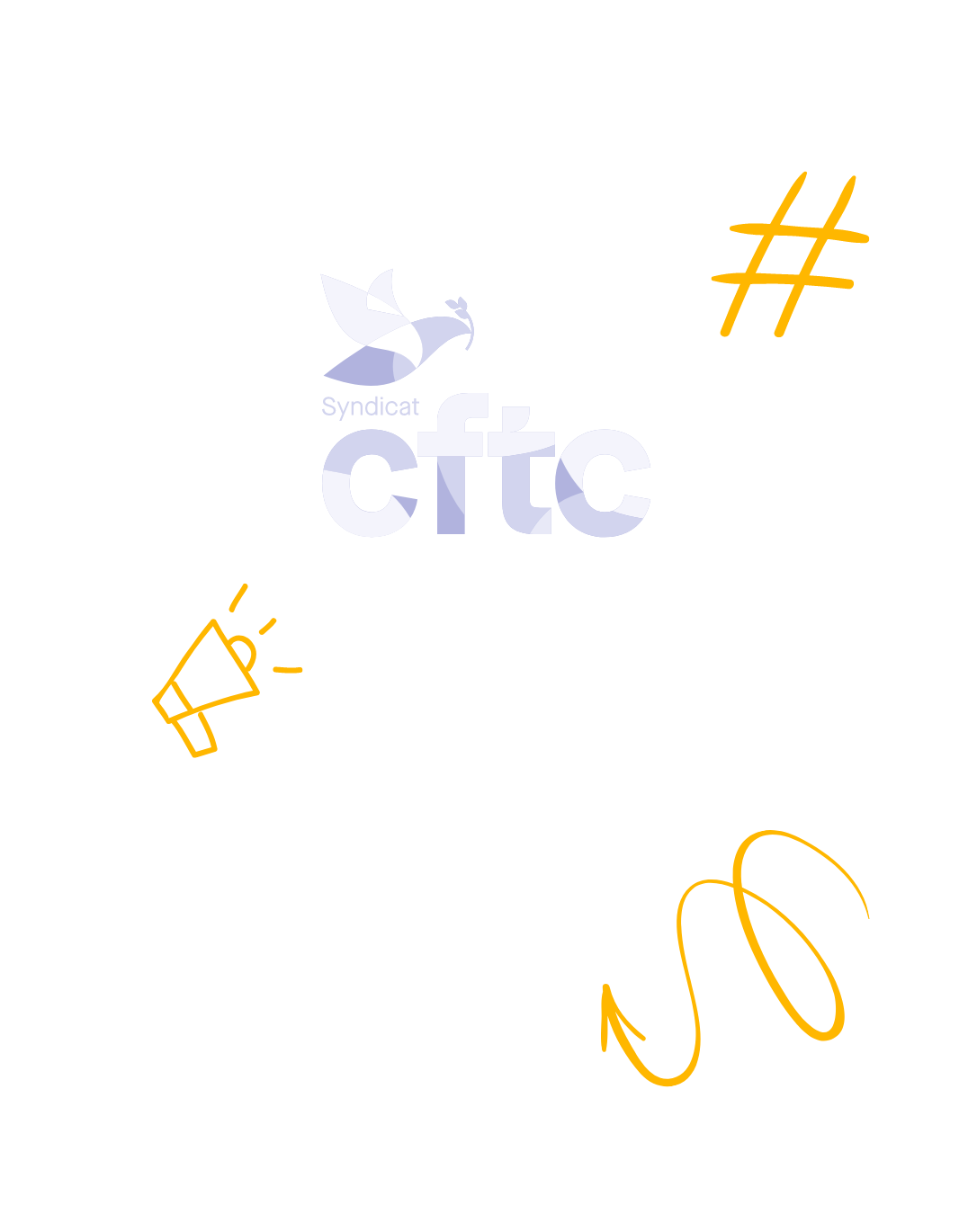Le Code du travail prévoit plusieurs dispositifs en soutien aux entreprises qui rencontrent des difficultés économiques, une baisse d’activité ou le besoin de se restructurer. L’objectif est double : permettre à l’employeur d’assurer la pérennité de son entreprise, tout en préservant un maximum d’emplois et en accompagnant au mieux ses salariés.

Qu’entend-on par “dispositifs de crise” ?
À savoir
On considère qu’une entreprise rencontre des difficultés économiques lorsqu’elle fait face à une baisse de son chiffre d’affaires, à un ralentissement du nombre de commandes, à une dégradation de sa trésorerie ou encore à des pertes d'exploitation.
Quels sont les dispositifs mobilisables ?
En fonction de sa situation et de ses objectifs, une entreprise “en crise” peut recourir à :
- un plan de départ volontaire (PDV), pour réduire durablement ses effectifs sans recourir à des licenciements, face à des difficultés économiques ou à un besoin de restructuration ;
- un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), pour accompagner au mieux les salariés visés par un projet de licenciement économique collectif et limiter le nombre de licenciements effectifs, via des solutions de reclassement et de mobilité ;
Attention
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, la mise en place d’un PSE est obligatoire dès lors que le projet de licenciement économique concerne au moins 10 salariés sur une période de 30 jours. Il devient également obligatoire dans le cadre d’un PDV si le nombre de départs envisagés atteint le seuil de 10 départs sur 30 jours.
- une rupture conventionnelle collective (RCC), pour procéder à des ruptures de contrats à l’amiable dans le cadre d’un accord collectif, sans avoir à justifier de difficultés économiques ;
- une activité partielle de longue durée “rebond” (APLD rebond ou APLD-R), pour réduire le temps de travail des salariés tout en assurant leur maintien dans l’emploi, face à une baisse d’activité durable ne compromettant pas sa pérennité ;
- un accord de performance collective (APC), pour aménager la durée du travail, les rémunérations ou les conditions de mobilité, face à des nécessités liées à son fonctionnement, au marché ou à l’emploi.
Comment l’employeur doit-il procéder ?
Ces dispositifs sont plus ou moins encadrés. Certains peuvent être mis en place par décision unilatérale de l’employeur ou accord collectif (PDV, PSE, APLD rebond), quand d’autres reposent nécessairement sur un accord négocié entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives (RCC, APC).
Les détails de la procédure dépendent donc à la fois des modalités de mise en place, des dispositions légales et des conditions définies dans l’accord collectif ou le document unilatéral.
Attention
Les dispositions d’un PSE, d’une RCC et d’une APLD rebond sont toujours soumises au contrôle de l’administration, plus précisément de la DREETS. Leur mise en œuvre n’est possible qu’après validation (en cas d’accord collectif) ou homologation (en cas de décision unilatérale), tout document établi unilatéralement par l’employeur faisant l’objet d’un contrôle renforcé.
Quels sont les conséquences et les avantages de ces dispositifs pour les salariés ?
L’ensemble de ces dispositifs tendent à éviter les départs contraints, via des ruptures à l’amiable ou une modification des contrats (durée du travail, rémunération…). Lorsqu’un salarié est finalement licencié pour motif économique à l’issue d’un PSE, il bénéficie d’une procédure strictement encadrée par la loi et d’un certain nombre de garanties.
| CONSÉQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL | DROITS DU SALARIÉ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de départ volontaire (PDV) | |||||||||||||||||||
| Rupture à l’amiable sans préavis uniquement si le salarié se porte volontaire. |
Indemnité de rupture au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, mesures d’accompagnement en matière d’emploi et de formation, allocation chômage. |
||||||||||||||||||
| Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) | |||||||||||||||||||
| Licenciement pour motif économique uniquement si le salarié ne peut être reclassé sur un poste équivalent (ou un poste de catégorie inférieure avec son accord). |
ndemnité légale ou conventionnelle de licenciement, mesures d’accompagnement renforcées, dispositifs spécifiques (contrat de sécurisation professionnelle ou congé de reclassement), allocation chômage. |
||||||||||||||||||
| Rupture conventionnelle collective (RCC) | |||||||||||||||||||
| Rupture à l’amiable dans les conditions prévues par accord collectif uniquement si le salarié se porte volontaire. |
Indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, mesures d'accompagnement, allocation chômage. |
||||||||||||||||||
| Activité partielle de longue durée rebond (APLD rebond) | |||||||||||||||||||
| Maintien du contrat avec réduction du temps de travail. |
Garantie d’emploi, allocation égale à 70 % du salaire brut pour chaque heure chômée (dans la limite de 4,5 fois le Smic). |
||||||||||||||||||
| Accord de performance collective | |||||||||||||||||||
| Maintien du contrat avec application automatique des modifications prévues dans l’accord si le salarié accepte Maintien du contrat sans modifications ou licenciement si le salarié refuse. |
Garantie d’emploi et mesures d’accompagnement si le salarié accepte Indemnité légale ou conventionnelle, allocation chômage et abondement du CPF si le salarié est licencié. |
||||||||||||||||||
Les représentants du personnel doivent-ils être consultés ?
Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique (CSE), dans les entreprises d’au moins 11 salariés, varient selon les dispositifs. De manière générale, le CSE doit être consulté avant toute modification des conditions de travail ou d’emploi décidée unilatéralement par l’employeur.
Ainsi, la consultation du CSE est obligatoire avant la mise en place unilatérale d’un PDV, qui, même sans départs contraints, vise à réduire durablement les effectifs. En cas de PSE, le CSE doit rendre son avis sur le document unilatéral élaboré par l'employeur. Cette consultation s’inscrit dans une procédure légale encadrée et conditionne l'homologation du plan par l’administration.
L'employeur qui souhaite recourir à l'APLD rebond par décision unilatérale doit consulter le CSE avant de réduire le temps de travail de ses salariés.
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (RCC), nécessairement mise en place par accord collectif, la consultation du CSE est obligatoire si le projet impacte
le fonctionnement général de l’entreprise. Il en va de même dans le cadre d’un accord de performance collective (APC), négocié entre l’employeur et les syndicats.
Ces consultations obligatoires permettent au CSE de peser dans la mise en place des dispositifs et la teneur des engagements de l’employeur, notamment pour un meilleur accompagnement des salariés impactés.
En outre, l’employeur est toujours tenu à une obligation d’information vis-à-vis du CSE, même lorsqu’il n’a pas à le consulter. Informés des avancées et des enjeux de la procédure, les représentants du personnel peuvent à leur tour informer les salariés, les conseiller et les accompagner au mieux dans ces périodes, souvent délicates, de changements.
Le salarié peut-il contester la rupture de son contrat de travail ?
Le salarié dont le contrat a été rompu d’un commun accord avec l’employeur dans le cadre d’un plan de départ volontaire (PDV) ne peut pas contester le motif économique de cette rupture, ni l'application des critères d'ordre des départs. En revanche, un recours devant le conseil de prud’hommes reste possible en cas de vice du consentement ou de non-respect par l’employeur des dispositions du plan.
Le salarié volontaire au départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (RCC) dispose d’un droit de rétractation : il peut revenir sur sa décision dans les conditions fixées par l'accord collectif. Il peut aussi saisir le conseil de prud’hommes en cas de vice du consentement ou de non-respect par l’employeur des engagements de l’accord.
Le salarié licencié pour motif économique après la mise en place d’un PSE peut contester la rupture de son contrat devant le conseil de prud’hommes, s’il estime, par exemple, que l’employeur n’a pas respecté la procédure du licenciement économique ou les critères d’ordre des licenciements.
Enfin, le salarié licencié après avoir refusé l’application d’un accord de performance collective (APC) peut contester son licenciement devant le conseil de prud’hommes s’il estime que l’employeur n’a pas respecté la procédure.
À savoir
Le salarié qui souhaite contester son licenciement ou la rupture conventionnelle de son contrat dispose d’un délai de 12 mois pour saisir le conseil de prud’hommes. À la suite d’un départ volontaire, ce délai est porté à 2 ans, conformément au délai de prescription de droit commun. Les actions devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire se prescrivent dans un délai de 2 mois.