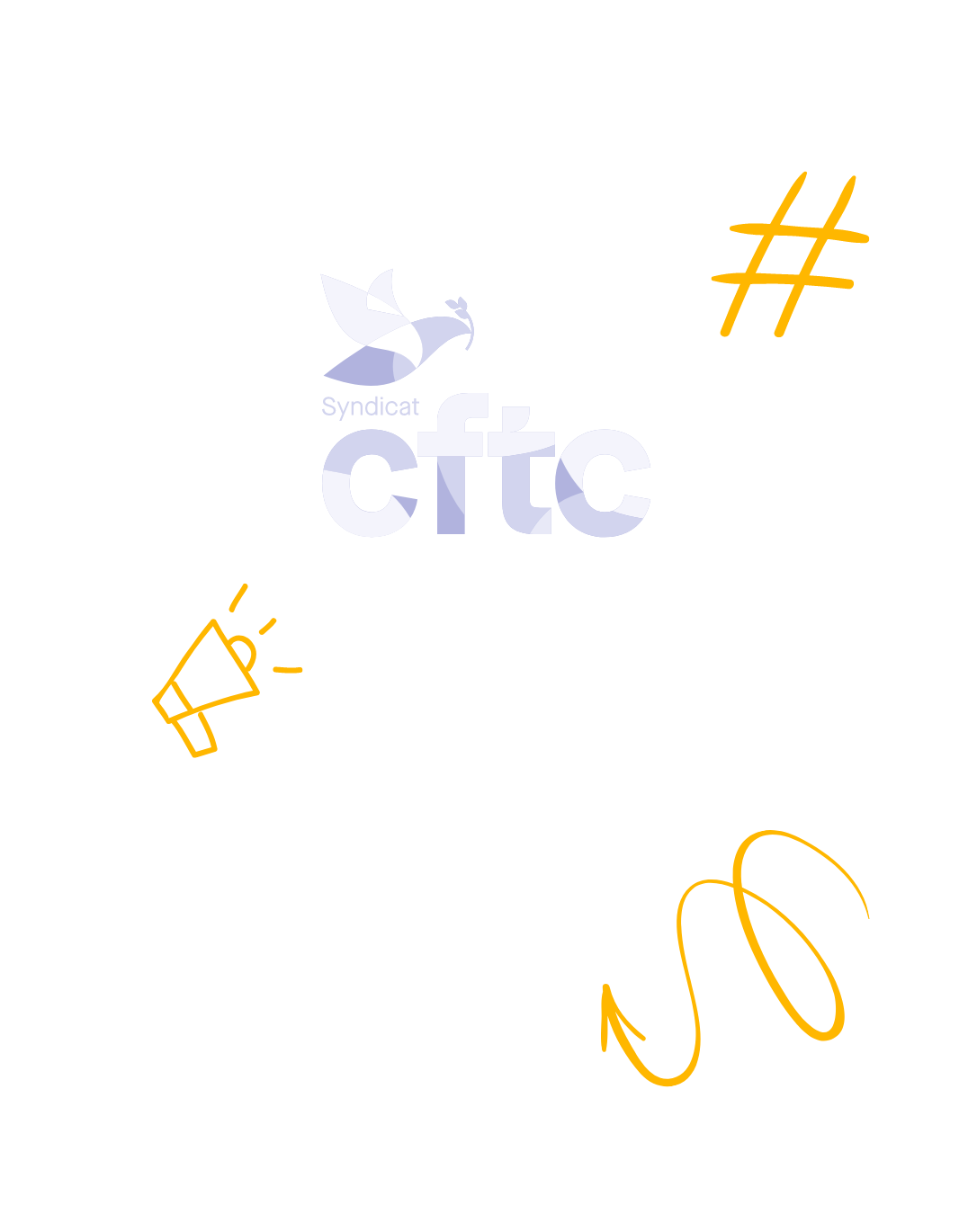La loi identifie 6 infractions constitutives de travail illégal (art. L. 8211-1 C. trav.) qu’il convient de bien distinguer.

Les différentes formes de travail illégal
Le travail dissimulé
Le travail dissimulé correspond au fait de dissimuler intentionnellement une activité ou un emploi salarié (en tout ou partie) aux pouvoirs publics.
- La dissimulation d’une activité se traduit par le non-respect d’une obligation déclarative liée à cette activité (art. L. 8221-3 et suiv. C. trav.). C’est par exemple le cas d’une “entreprise” qui commercialise des produits sans être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou qui ne déclare pas une partie du chiffre d’affaires réalisé.
- La dissimulation d’un emploi salarié se caractérise par la soustraction de l’employeur à l’obligation de déclarer ses salariés aux organismes de recouvrement de cotisations sociales (Urssaf) (art. L. 8221-5 et suiv. C. trav.). Elle peut notamment découler de l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de la non-remise de fiches de paie ou de la mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
À savoir
L’utilisation de faux statuts relève également du travail dissimulé. Les “faux stagiaires”, les “faux travailleurs indépendants” (autoentrepreneurs), les “faux bénévoles” travaillent dans des conditions très proches du salariat, sans bénéficier des avantages et des protections qu’offre le statut de salarié.
Les cas sont par exemple fréquents chez les travailleurs des plateformes numériques, qui, bien que se pliant aux règles et consignes décidées par l’application qu’ils utilisent, exercent leur activité sous le statut de micro-entrepreneur. Grâce à l’évolution de la législation, ces indépendants sont de plus en plus nombreux à réclamer – et à obtenir – la requalification de leur statut devant le conseil de prud’hommes et la conclusion d’un contrat de travail.
Travail détaché et travail dissimulé

Le travail détaché correspond à la situation du salarié qui est envoyé temporairement en France par une entreprise établie à l’étranger, tout en restant affilié à la sécurité sociale de son pays d’origine.
Ce mécanisme, qui permet parfois de réduire artificiellement le coût du travail par l’application des règles sociales du pays d'envoi, peut être détourné et conduire à des formes de travail dissimulé, difficiles à contrôler et à régulariser.
L’emploi d’étrangers non autorisés à travailler en France
Nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer un étranger non muni d’un titre de travail l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.
Attention
La présentation de faux documents par le travailleur étranger ne disculpe pas l’employeur, qui, en cas de doutes, est tenu de procéder aux vérifications nécessaires.
Tout ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit être en possession d’une autorisation de travail pour pouvoir exercer une activité salariée en France, quelles que soient la nature et la durée du poste, et quand bien même il disposerait d’un titre l’autorisant à séjourner en France.
Exemple : un serveur de nationalité brésilienne titulaire d’une carte de résidence belge peut séjourner en France, mais n’est pas autorisé à travailler pour le compte d’un employeur français sans autorisation expresse de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), ou sans document de la préfecture lui permettant de travailler en France.
Le marchandage
Le délit de marchandage est constitué lorsqu’un prêt de main-d'œuvre revêt un but lucratif (pour l’entreprise prêteuse et/ou l’entreprise utilisatrice) et cause un préjudice au salarié mis à disposition ou contourne les dispositions prévues par la loi ou la convention collective applicable.
Exemple : un garage automobile envoie l’un de ses mécaniciens travailler temporairement pour un autre garage, en facturant cette mise à disposition. Si, en plus, ce montage conduit le salarié à être rémunéré ou traité moins favorablement que s’il avait été directement embauché par le second garage, il s’agit d’un cas de marchandage.
Le prêt illicite de main-d'œuvre
Le Code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre.
À savoir
Cette interdiction ne s’applique pas aux entreprises de travail temporaire ni aux agences de mannequins sous licence.
D’autres dérogations sont expressément prévues par la loi, notamment dans le cadre de la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 du Code du travail.
Le cumul irrégulier d’emplois
Le cumul d’emplois est autorisé par la loi mais limité : il est interdit au salarié d’accomplir des tâches rémunérées au-delà des durées maximales de travail en vigueur dans sa profession. De son côté, l’employeur ne peut recourir aux services d’un salarié qui se soustrait à cette interdiction.
Exemple : un salarié occupe à l’année un poste de caissier à temps plein (35 heures par semaine) et un poste de veilleur de nuit à temps partiel (15 heures par semaine). Il se rend ainsi coupable de travail illégal, tout comme chacun de ses employeurs.
À savoir
Le salarié qui cumule plusieurs emplois est tenu de communiquer à ses employeurs tout document utile permettant de contrôler sa situation et le nombre total d’heures travaillées. Le dépassement de la durée maximale applicable peut justifier un licenciement.
Certaines tâches expressément prévues par la loi sont exclues de cette interdiction :
- les travaux accomplis par le salarié pour son propre compte ;
- les petits travaux ménagers réalisés chez des particuliers ;
- les travaux d'extrême urgence devant être effectués sans délai pour prévenir des accidents imminents ou organiser des opérations de sauvetage ;
- les travaux de nature scientifique, littéraire ou artistique ;
- les participations aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance.
Attention
Le cumul d’emplois n’est pas toujours possible. Il peut être interdit par des dispositions conventionnelles (convention collective, accord d’entreprise…). Le contrat de travail du salarié peut également comporter une clause d'exclusivité lui interdisant de travailler pour un autre employeur.
La fraude aux revenus de remplacement
Le fait de percevoir, ou de tenter de percevoir, indûment et en toute connaissance de cause, certaines prestations versées en remplacement du salaire constitue une forme de travail illégal.
Les prestations concernées sont :
- les allocations destinées aux demandeurs d’emploi (allocation de retour à l’emploi, allocation de solidarité spécifique, etc.) ;
- les aides accordées en cas d’activité partielle ;
- les aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle attribuées par convention.
Exemple : une entreprise en difficulté décide de recourir à l’activité partielle et déclare suspendre totalement l’activité de ses salariés, mais demande à ces derniers de continuer à travailler à mi-temps en télétravail.
Les sanctions contre le travail illégal
Au regard de ses multiples conséquences économiques, juridiques, sociales, voire sanitaires, le travail illégal fait l’objet d’un plan de lutte national et de contrôles sans cesse renforcés.
Les sanctions prononcées à l’encontre de ses auteurs peuvent être de plusieurs natures : pénales, civiles et administratives. Elles dépendent de l’infraction constatée et peuvent se cumuler.
Les sanctions pénales
L’ensemble des infractions relevant du travail illégal sont des infractions pénales (délit ou contravention selon la nature de l’infraction). Elles exposent donc leurs auteurs aux sanctions prévues par le Code pénal.
À savoir
Pour qu’une infraction pénale soit caractérisée, 3 éléments doivent être réunis :
- un élément légal, à savoir une loi décrivant et interdisant les faits visés ;
- un élément matériel (les faits, actes ou omissions violant cette loi) ;
- un élément moral, c’est-à-dire que les faits interdits doivent avoir été commis intentionnellement.
Par exemple, si des heures supplémentaires n’ont pas été payées au salarié, il faut que l’employeur ait sciemment manqué à son obligation de paiement. Le non-paiement seul ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé.
En cas de travail dissimulé
Le travail dissimulé constitue un délit.
Peuvent être sanctionnés (personnes physiques ou personnes morales) :
- l'auteur du délit qui a dissimulé son activité ou celle de ses salariés ;
- le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui a eu recours aux services de l’auteur en toute connaissance de cause ;
- le complice ayant facilité la préparation ou la consommation du délit.
- toute personne ayant fait la publicité du travail dissimulé.
Ces personnes sont passibles de :
- 3 ans d’emprisonnement ;
- 45 000 € d’amende (225 000 € pour une société).
Si le délit concerne un mineur ou une personne vulnérable/dépendante, les sanctions sont portées à :
- 5 ans d’emprisonnement ;
- 75 000 € d’amende (375 000 € pour une société).
Si le délit est commis en bande organisée, les sanctions sont portées à :
- 10 ans d’emprisonnement ;
- 100 000 € d’amende (500 000 € pour une société).
En cas d’emploi d’étrangers non autorisés à travailler en France
L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers constitue un délit. Peuvent être sanctionnés (personnes physiques ou personnes morales) :
- l'auteur du délit (employeur) ;
- toute personne qui recourt aux services du travailleur étranger en ayant connaissance de l’irrégularité de sa situation ;
- tout complice ayant facilité la préparation ou la consommation du délit.
Les sanctions peuvent atteindre des milliers d'euros d'amende par étranger concernés et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes.
Attention
L’emploi d’un étranger non autorisé à travailler est également susceptible de constituer un délit d'aide au séjour irrégulier, lequel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Par ailleurs, toute fraude ou fausse déclaration visant à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger une autorisation de travail est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 000 € d'amende.
En cas de marchandage ou de prêt illicite de main-d'œuvre
Ces deux formes de travail illégal liées à la fourniture de main-d'œuvre constituent des délits.
Peuvent être sanctionnés (personnes physiques ou personnes morales) :
- les auteurs du délit (fournisseurs ou utilisateurs de la main-d'œuvre) ;
- tout complice ayant facilité la préparation ou la consommation du délit.
Les sanctions sont fixées à :
- 2 ans d’emprisonnement ;
- 30 000 € d’amende (150 000 € pour une société).
Si le délit est commis en bande organisée, les sanctions sont portées à :
- 10 ans d’emprisonnement ;
- 100 000 € d’amende (500 000 € pour une société).
En cas de cumul irrégulier d'emplois
À l’inverse des autres formes de travail illégal, le non-respect des règles relatives au cumul d’emplois constitue une contravention, et non un délit.
Peuvent être sanctionnés :
- l’auteur de la contravention (salarié) ;
- toute personne qui recourt aux services du salarié en ayant connaissance de l’irrégularité de sa situation.
Le cumul irrégulier d’emplois par un salarié ou le recours à un salarié cumulant irrégulièrement plusieurs emplois est passible de:
- 1 500 € d’amende (3 000 € en cas de récidive).
En cas de fraude aux revenus de remplacement
Toute pratique frauduleuse destinée à percevoir indûment l’une des prestations listées par la loi constitue un délit. Peuvent être sanctionnées :
- la personne qui bénéficie ou tente de bénéficier frauduleusement de ces prestations ;
- la personne qui fait obtenir ou tente de faire obtenir frauduleusement ces prestations.
Les sanctions sont fixées à :
- 2 ans d’emprisonnement ;
- 30 000 € d’amende.
Attention
La fraude aux revenus de remplacement peut constituer un délit d'escroquerie sanctionné par 7 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l'escroquerie est réalisée au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public.
De possibles peines complémentaires

Des peines complémentaires peuvent être prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour travail dissimulé, emploi irrégulier d’étrangers ou marchandage/prêt illicite de main-d’œuvre. Il peut notamment s’agir, selon la nature du délit, de :
- la diffusion du jugement sur le site web du ministère du Travail ;
- l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ;
- la destitution des droits civiques (ex. : droit de vote) et civils (ex. : mariage) ;
- l’exclusion temporaire ou définitive des marchés publics.
Par ailleurs, des sanctions pénales pour des délits connexes (abus de vulnérabilité, trafic de main-d’œuvre étrangère, usage de faux documents…) peuvent venir se cumuler aux sanctions pour délit de travail illégal.
Les sanctions civiles
Des sanctions civiles sont prévues par le Code de la sécurité sociale à l’encontre des auteurs des délits de :
- travail dissimulé ;
- emploi d’étrangers non autorisés à travailler en France ;
- marchandage ;
- prêt illicite de main-d'œuvre.
Il s’agit, d’une part, d’un redressement de cotisations (paiement des cotisations dues avec majoration), et/ou, d’autre part, d’une annulation des exonérations ou réductions de cotisations ayant pu bénéficier à l’auteur du délit.
À savoir
En matière de travail illégal, les actions en recouvrement et l’annulation des réductions ou exonérations peuvent s’appliquer dans la limite d’un délai de prescription de 5 ans.
Le montant du redressement est calculé sur une base forfaitaire correspondant à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 11 775 € pour les délits constatés en 2025.
Le taux de majoration est porté à 40 % du PASS (soit 18 840 € en 2025) si le délit de travail illégal est commis en bande organisée ou s’il implique :
- plusieurs salariés ;
- un mineur ;
- une personne vulnérable ou dépendante.
En cas de récidive dans les 5 ans suivant le premier redressement, un taux de majoration plus élevé s’applique :
- 45 % si le taux lors de la première condamnation était de 25 % ;
- 60 % si le taux lors de la première condamnation était de 40 %.
À savoir
Une réduction de 10 points est accordée si le mis en demeure paie l’ensemble des sommes dues ou présente un plan de paiement accepté par l’Urssaf dans un délai de 30 jours. Cette réduction ne s’applique pas en cas de récidive.
Si l’employeur est en mesure d’apporter des données réelles sur le volume d’heures effectivement travaillées et les rémunérations effectivement versées, alors le redressement est calculé à partir de ces données réelles.
-
1,6 milliard d'euros
C’est le montant des cotisations redressées au titre du travail dissimulé en 2024, contre 1,2 milliard en 2023 et 0,8 milliard en 2022.
L'Urssaf continue de renforcer son engagement dans la lutte contre le travail illégal en menant des actions de prévention et de répression dans les secteurs les plus sujets à la fraude.
Les sanctions administratives
Les sanctions civiles et pénales peuvent être complétées par des sanctions de nature administrative, lorsqu’un procès-verbal constatant une situation de travail illégal est dressé par les services compétents. Il peut alors s’agir :
- de la fermeture temporaire des établissements concernés, avec éventuellement saisie conservatoire du matériel professionnel, pour une durée de 3 mois maximum ;
- d’une inéligibilité aux aides publiques (ex. : allocation d’activité partielle, aide à l’embauche pour un contrat d’apprentissage…) pour une durée de 5 ans maximum ;
- d’une exclusion temporaire des contrats administratifs pour une durée de 6 mois maximum.
À savoir
Le remboursement des aides publiques perçues au cours des 12 derniers mois peut également être réclamé.
La réparation aux victimes de travail illégal
Même non déclaré ou en situation irrégulière, le salarié possède des droits garantis par le Code du travail. Les victimes de travail illégal peuvent également obtenir réparation devant la justice et bénéficier de l’appui des syndicats de salariés.
Les dispositions communes à tous les salariés
Le salarié placé en situation de travail illégal, quelle qu’en soit la forme, a droit à la remise d’un contrat de travail, de fiches de paie et d’un certificat de travail.
Il doit percevoir le salaire et les accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi et/ou de la convention collective applicable. Il bénéficie également des mêmes droits que les autres salariés en matière de congés payés, RTT...
Par ailleurs, la victime de travail illégal peut prétendre à une indemnisation en réparation du préjudice subi. Il lui est possible d’agir devant :
- le conseil de prud’hommes, en faisant établir les manquements de l’employeur (contrat de travail irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-paiement des heures supplémentaires/complémentaires...) ;
- la justice pénale, en portant plainte et en se constituant partie civile au titre du préjudice moral résultant de l’illégalité de la situation dans laquelle son employeur l’a placé.
À savoir
La fermeture administrative éventuellement prononcée à l’encontre de l’employeur n'entraîne ni rupture ni suspension du contrat de travail pour les salariés des établissements concernés.
L’indemnisation aux victimes de travail dissimulé
Un travailleur engagé dans des conditions de travail dissimulé et licencié dans ce contexte a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Celle-ci est cumulable avec les autres indemnités et rappels de salaire versés par l’employeur, y compris avec l’indemnité de licenciement. Son versement est également possible en cas de démission.
Attention !
L’octroi de cette indemnité n’est en revanche pas systématique : le salarié doit démontrer le caractère intentionnel du manquement commis par l’employeur. Les juges apprécient souverainement cet aspect au regard de tous les éléments qui leur sont transmis.
La protection des étrangers employés illégalement
Le salarié étranger employé sans titre de travail bénéficie de certaines protections prévues par la loi (art. L. 8251-1 à L. 8256-8 C. trav.). L’agent de contrôle ayant constaté l’irrégularité doit lui remettre un document l’informant de ses droits.
Les étrangers employés illégalement sont assimilés, à compter de la date de leur embauche, à des salariés régulièrement engagés au regard des obligations de l’employeur, notamment en matière de :
- durée du travail, repos et congés ;
- santé et sécurité au travail ;
- salaire et accessoires de salaire (conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles) ;
- maternité.
Lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié peut bénéficier d'indemnités selon sa situation.
Attention !
La protection du salarié étranger en situation de travail illégal reste tout de même plus faible que celle des autres salariés. Par exemple, en cas de rupture du contrat de travail, son indemnité forfaitaire sera réduite à 3 mois de salaire s’il n’est pas en mesure de prouver qu’il a travaillé davantage sans être rémunéré.
De même, ce salarié ne pourra pas cumuler l’indemnité de travail dissimulé avec le rappel des sommes qui lui sont dues au titre de son contrat : seul le montant le plus favorable des deux lui sera versé.
À savoir
Le salarié étranger qui a subi des conditions de travail ou d’hébergement indignes, a perçu une rémunération sans rapport avec le travail fourni ou a été victime de traite des êtres humains peut porter plainte contre son employeur et saisir la justice pénale.
L’action en justice des syndicats de salariés

Selon les dispositions du Code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal, les organisations syndicales représentatives des salariés à l’échelle nationale, telles que la CFTC, sont autorisées à exercer en justice des actions en faveur des salariés en situation irrégulière sans avoir à justifier du mandat de ces derniers.
L’organisation syndicale doit simplement informer le salarié concerné par tout moyen daté précisant la nature et l’objet de l’action envisagée. En l’absence d’opposition sous un délai de 15 jours, l’action peut être menée. Le salarié conserve la possibilité d’intervenir dans la procédure engagée et d’y mettre un terme à tout moment (art. L. 8223-4 C. trav.).